Revenir à 2003. Itinéraires culturels : une proposition alternative pour la diversification du tourisme. Rapport pour le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe (1)
A la fin de l'année 2002, le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLRE) du Conseil de l'Europe (COE) a souhaité que l'Institut européen des Itinéraires culturels (IEIC) prépare un rapport sur l'importance que prenait le tourisme culturel au niveau régional en Europe.
Je décris en annexe la manière dont s'est déroulée cette commande qui, compte tenu de sa date, est venue compléter et influencer la phase de rédaction du site web / base de données de l'Institut européen des Itinéraires culturels (IEIC) en cours d'élaboration dont j'ai évoqué la disparition dans un post précédent et en a commandé certains des grands chapitres.
Il me semble que ce rapport n'a en rien perdu de son actualité, sauf bien sûr en ce qui concerne les statistiques citées qui devraient, pour certaines, être actualisées.
Ne figurant plus sur internet, comme des milliers d'autres informations rendues inaccessibles, il méritait de faire partie, parmi les premiers, du travail de mémoire qui constitue l'objectif même de ce blog.
Il sera donc l'objet de deux articles complémentaires.
Le premier porte sur les évolutions du tourisme culturel avec une annexe présentant les conditions de la commande (1).
Le second insiste sur l'originalité des ICCE, en réponse au développement du tourisme culturel, ainsi que l'historique de leur mise en oeuvre concrète, de 1984 à 2003.
Une réponse pertinente susceptible d'apporter des réponses, diversifiées en matière de thèmes, de coopérations européennes et de valeurs démocratiques, aux mutations des besoins ressentis pour assurer une maîtrise d'un développement touristique local fondé sur l'histoire, la mémoire et le patrimoine.
Le tourisme culturel fait l'objet depuis une vingtaine d'années d'un regain d'intérêt qui fait suite à la fois :
- aux démarches éthiques et volontaristes des Institutions intergouvernementales (2);
- aux lassitudes suscitées par le tourisme de masse, tant de la part des touristes eux-mêmes que des responsables de sites qui ne peuvent plus faire face à une augmentation croissante des dépenses engendrées, sans retombées économiques locales équivalentes et à l'usure des équipements;
- aux événements politiques qui ont fermé certaines destinations exotiques privilégiées par le tourisme de pur loisir;
- aux crises rencontrées ces dernières années par les compagnies de transport, en particulier les compagnies aériennes;
- à l'ouverture au tourisme de nouveaux pays, en particulier en Europe centrale et orientale;
- aux besoins des collectivités locales et régionales de répondre aux aspirations de leurs habitants en terme de développement durable;
- aux besoins rencontrés par les grandes Régions d'Europe de donner à la fois une image et un message touristiques spécifiques - différents de ceux de leurs concurrentes - et de reconvertir des espaces délaissés par suite des grandes reconversions économiques : désertification des espaces ruraux et valorisation des friches industrielles, abandon des ouvrages militaires ou de défense, par exemple;
Mina de Llorts. Andorre. Cliché MTP.
- aux transferts de compétence en matière de tourisme des Etats vers les Régions (Italie au milieu des années 90, France aujourd'hui) quand ce n'était pas déjà le cas dans les Etats fédéraux.
L'Institut a été sollicité à de nombreuses reprises pour travailler sur la question essentielle de la mise en tourisme du patrimoine et de la culture. De la conférence de Gdansk en 1997 organisée par les organisations touristiques baltes (The Baltic Sea Tourism Commission), à la préparation du Sommet de la Grande Région en 2000 ou à sa collaboration au programme PICTURE de l’Union Européenne ("Proactive management of the impact of cultural tourism on urban resources and economies"), ce sont des questions d'éthique et des questions pratiques qui ont été posées.
Qu'est-ce qu'un tourisme culturel? Comment le définir? Quelle signification sociale, culturelle, économique a-t-il?
Enfin, qu'apporte le tourisme culturel aux lieux qui l'accueillent? Leur est-il utile? Doivent-elles le contrôler? Et quelle est son histoire?
L'Institut a réuni, et ceci depuis sa création, une somme documentaire très complète sur le tourisme culturel, fondée sur des réunions auxquelles il a participé ou qu'il a contribué à organiser avec des Etats, des Régions et des villes, par exemple à :
Liège, Tournai et Butgenbach en Belgique, Nantes, Lyon et Paris en France, Barcelone, Logroño et Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, Milan, Venise et Florence en Italie, Budapest en Hongrie, Sinaïa en Roumanie, Skopje en République de Macédoine, Gdansk en Pologne, voire Khiva en Ouzbekistan et Hanoi au Vietnam du Nord…Il a reçu plusieurs stagiaires de différents pays européens qui ont travaillé sur ces questions pour des périodes atteignant plusieurs mois.
Si l'on prend en compte la définitions qu'en donnent les acteurs touristiques, la notion de produit touristique désigne de manière habituelle un ensemble de prestations qui peuvent être vendues séparément, ou bien de manière groupée : transport, hébergement, restauration (encadrement - accueil, guides, accompagnateurs), animation, assurances et si c'est nécessaire, assistance.
Les catalogues des grands tour-opérateurs, mais aussi, de plus en plus, ceux des offices de tourisme des collectivités territoriales en montrent de nombreux exemples.
Mais ces exemples restent dans une typologie encore très peu diversifiée. Il est en effet plus facile - et donc plus rentable - de proposer des produits clefs en main qui ne nécessitent pas d'investissements majeurs liés à la valorisation du patrimoine ou de travaux de recherche sur des circuits alternatifs.
Il faut cependant compter sur le fait que le comportement des touristes a évolué de manière essentielle au cours des dernières années :
de plus en plus de voyageurs choisissent en effet ces prestations à leur gré et non plus comme un "package", pour des séjours à la carte qu'ils organisent eux-mêmes et ceci de plus en plus au dernier moment et pour des périodes de plus en plus courtes.
Pour nuancer le propos, il faut cependant considérer que le besoin d'un intermédiaire - tour-opérateur, autocariste, agence réceptive - ou de plusieurs, se fait sentir de manière différente selon les pays (tourisme très organisé dans le nord de l'Europe, plus individualisé au sud), sans parler des différences de comportement entre les classes d'âges que reflète bien la gamme des guides touristiques publiés : du guide sac à dos à l'encyclopédie de voyage.
Les circuits aventure, les courts séjours, les produits "d'une journée", les circuits "libres" laissant une grande part de la programmation aux touristes, les locations de vélos, de péniches, d'attelages ont fait leur apparition dans les catalogues.
Une route littéraire : Chemin de Robert Louis Stevenson dans les Cévennes. Copyrights Association Stevenson et Alain Lagrave.
Devant ce comportement évolutif plus exigeant, la composante culturelle et patrimoniale a de fait également évoluée, en répondant à ce besoin de diversification de l'offre, ainsi que pour les raisons d'aménagement du territoire que nous évoquions plus haut.
Mais aussi du fait de l'importance grandissante des produits dérivés, qui deviennent un complément non négligeable en terme de revenus, même si la Réunion des Musées Nationaux français insiste sur une décroissante récente de cet intérêt.
Le circuit de visite traditionnel est devenu une visite spectacle ou une visite contée, les boutiques de musées se sont enrichies en proposant des produits régionaux, voire des spécialités dans le domaine des productions agricoles…
Si les monuments majeurs et les centres historiques des villes restent toujours des attractions majeures (12 millions de visiteurs pour Notre-Dame de Paris, plus de 2 millions pour l'Alhambra de Grenade, 2 millions et demi pour le centre de Bruxelles et presque 3 millions à Florence et 6 à Venise), certains faits et certains chiffres donnent à réfléchir sur le rôle que les Régions ainsi que les villes petites et moyennes peuvent jouer dans la mise en œuvre de nouvelles propositions à partir de sites patrimoniaux alternatifs, de paysages culturels, d'événements culturels ou de nouvelles démarches territoriales.
Les nouveaux produits
- Les opérateurs régionaux proposent en effet avec succès des circuits
thématiques, des séjours à la ferme, des découvertes nocturnes.
- La prise en compte du paysage culturel a amené les opérateurs réceptifs
à proposer des excursions fondées sur la biologie ou la gastronomie, les
produits du terroir, l'astronomie, la visite des entreprises de production
artisanale ou industrielle…
- Aux grands sites archéologiques classiques du pourtours méditerranéen,
se sont ajoutés des sites plus méconnus le long de la Mer Noire, en Roumanie ou
en Bulgarie, voire dans les pays de la zone caucasienne. Mais surtout, un vif
intérêt est apparu pour les sites Vikings, non seulement en termes de visites,
mais surtout dans des propositions touristiques de participation aux fouilles.
- Le travail d'archéologie sur les sites industriels a conduit à un
intérêt certain : Lewarde, un site minier du nord de la France reçoit
pratiquement 200.000 visiteurs par an.
- La parfumerie de Grasse atteint 400.000 visiteurs et les usines de
l'aérospatiale à Toulouse 72.000 visiteurs.
- Les sites militaires (forteresses, fortifications, bastides, lignes de
défense) ont été muséographiés et constituent maintenant des hauts lieux du
tourisme atteignant plusieurs centaines de milliers de visiteurs. L'itinéraire
Wenzel à Luxembourg ville compte entre cent et cent cinquante mille visiteurs
payants par an et au moins autant en visite libre.
- Les Parcs et les sites naturels sont de plus en plus fréquentés : (Plusieurs millions de visiteurs pour chacun des grands parcs français), tandis que l'offre culturelle joue sur des thématiques de territoire, ainsi le grand succès remporté par les Routes du Baroque en Rhône-Alpes, les chemins d'Al-Andalus en Andalousie, ou même les Parcs naturels lituaniens où un séminaire organisé par l'Institut en 2002 a permis de souligner une montée du tourisme en provenance de Pologne ou d'Allemagne.
- Ceci sans parler de l'espace
gigantesque que les chemins de pèlerinage occupent en régions. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France et en Espagne accueillent des millions
de pèlerins et de randonneurs, mais il ne faut pas négliger l'importance
grandissante qu'ils prennent au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en
Allemagne ou en Suisse. Ils sont complétés depuis le Jubilée romain par les
routes vers Rome (Via Francigena).
- Les jardins historiques ou contemporains ne sont pas en reste. Dans ce domaine, le Royaume-Uni ne fait plus cavalier seul - la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne ou la Russie connaissent une évolution importante, même si l'un des plus grands succès en terme de démarche touristiques de ces toutes dernières années (si l'on met de côté le domaine de Versailles, la Villa d'Este ou Kew Gardens) reste le domaine de Heligan en Cornouailles avec près de 400.000 visiteurs dix années après son ouverture. Succès qui a été renouvelé avec l'inauguration en 2001, toujours en Cornouailles, de serres climatiques (Eden project) avec plus d'un million et demi de visiteurs par an et une mise en place dans les catalogues de nombreux tour-opérateurs européens.
Changements
des responsabilités
Nous avons insisté sur une évolution inéluctable en Europe qui se caractérise par le transfert de compétences - et de charges - des Etats vers les Régions en ce qui concerne le tourisme, le patrimoine et la culture au sens large.
Nous n'avons pu que le constater d'un point de vue qualitatif dans le cadre de la mise en œuvre des itinéraires culturels pour lesquels les propositions qui étaient au milieu des années quatre-vingt issues majoritairement des Etats ou de groupes d'Etats sont maintenant portées par des Régions.
Un des cas parmi d’autres est celui de l'itinéraire de la langue castillane (3), présenté au Conseil de l'Europe par le Conseiller à la culture du Gouvernement autonome de La Rioja, parlant au nom de trois autonomies et d'une dizaine de villes.
Nous pourrions également citer le fait que le gouvernement italien au travers des directions générales du patrimoine et du tourisme ont signé un accord avec trois réseaux de régions, provinces et villes italiennes pour la création d’un observatoire (consulta) des itinéraires culturels du Conseil de l’Europe en Italie.
Mais en ce qui concerne des itinéraires beaucoup plus anciens, les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, il est clair que l'Institut est maintenant confronté à un travail direct Région par Région (initiatives récentes de la Région Poitou-Charentes qui a édité le principal guide en français sur l'ensemble des chemins dans un contexte européen, Région Aquitaine, Région Basque espagnole, Comté des Cornouailles…).
Des régions de l'Est de l'Europe, dont l'autonomie administrative et financière commencent à s'affirmer ont également maintenant la même démarche. L'Institut est donc de plus en plus souvent amené à signer des Conventions de moyens et d'objectifs directement avec les gouvernements régionaux, une fois que les thèmes ont été élus par le Conseil de l'Europe.
Différents modèles de cogestion se mettent progressivement en place où les Régions tiennent un rôle de financeur principal et de médiateur entre l'Etat central qui conserve son rôle dans les domaines juridiques, de classement ou de protection, les organismes de gestion publics ou semi-publics qui agissent sur les territoires par délégation de l'Etat, les Organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre les projets - ceci parfois avec des moyens considérables, à l'égal du National Trust anglais - et les autres collectivités qui apportent leur financement et sont souvent propriétaires des sites.
Il s'agit de montages juridiques et financiers qui passent par des coopérations inter ministérielles, inter régionales et relient les Directions centrales de l'Aménagement du Territoire, les conservatoires régionaux du territoire et mettent en œuvre des conventions inter ministérielles, tout comme des conventions Etats - Régions.
Il est certain que parmi les recommandations à
présenter au Congrès, celle de l'analyse de ces nouveaux modèles - qui reste
pour l'instant très partielle - serait une priorité, ne serait-ce que pour
mettre en évidence les meilleures pratiques et orienter une bonne gouvernance
dans ce domaine.
Le cas des
musées sur des thèmes scientifiques et de production
On assiste à un phénomène parallèle - en ce qui concerne les musées - à celui que nous avions souligné pour les sites patrimoniaux : la diversification des intérêts des visiteurs.
A côté des musées d'art, les musées d'histoire naturelle, les musées scientifiques et techniques présentent une offre réellement innovante. Sans parler du succès des grands musées scientifiques et techniques (La Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris ou le Musée des techniques de Manchester sont des exemples dans ce domaine), l'Institut appuie chaque année un peu plus ses réseaux actifs en matière d'itinéraires culturels sur des musées très spécialisés sur le plan scientifique.
C'est le cas en particulier dans le domaine des routes de la soie et du textile (Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Nord Pas-de-Calais, Picardie en France, Lombardie et Piémont en Italie…voire en Roumanie, en République de Moldavie, en Ukraine ou en Géorgie).
Un musée régional comme celui d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne qui a
réouvert en 2001 constitue un des exemples les plus démonstratifs en présentant
les routes de la rubanerie et de la dentelle en Loire et Haute-Loire.
Il est frappant de constater que là également, les propositions techniques ou scientifiques, fondées sur des productions locales : routes du papier, du liège, du fer, des mines, de la construction navale…sont maintenant devenues très nombreuses, rendant par là même nécessaire la préparation d'une réunion générale sur ces questions que l'Institut réalisera courant 2003.
Il en va de même des productions agricoles. Les musées permanents ou les expositions temporaires sur le thème du paysage, des arbres, de la vigne, du blé, de l'élevage connaissent un développement important, tandis que les propositions d'itinéraires culturels sur les pratiques agropastorales (transhumance…) ou agricoles (l'itinéraire du froment en Méditerranée, les routes de l'olivier, du tabac, pour ne pas parler des routes du vin…) sont de plus en plus nombreuses.
On ne saurait être complet sur ce chapitre, mais il ne faut cependant pas oublier l'importance des expositions temporaires. Même si les expositions consacrées aux Impressionnistes, aux peintres du Baroque, aux grandes collections de tableaux américaines constituent en soi des arguments touristiques qu'ont su exploiter commercialement des villes comme Paris, Berlin (Avec la récente île des musées classée sur la Liste du Patrimoine mondial), Londres, Amsterdam, Budapest ou Prague, de nouvelles démarches se sont fait jour, en raison du coût devenu exorbitant de l'assurance des œuvres prêtées, surtout depuis le 11 septembre 2001.
Tout d'abord les expositions temporaires sont plus souvent coordonnées entre les grands et les plus petits musées. L'exemple du travail entrepris par la Région Wallonne dans ce domaine depuis quelques années et exemplaire (thèmes annuels sur l'offre touristique liée aux peintres Surréalistes ou à la Bande dessinée par exemple).
Mais surtout on constate que les autorités régionales cherchent - en conjonction avec les villes - à financer des expositions d'art majeures non plus seulement dans les capitales nationales ou les grandes capitales régionales, mais dans des villes dont l'économie, en particulier industrielle a du connaître une reconversion.
Le cas de Castres ou de Valenciennes en France et celui plus récent de Trévise en Italie, dont l'image était pratiquement absente dans le domaine de l'offre touristique pourraient être cités à titre d'exemple. Trévise chiffre à 20 millions d'Euros les retombées économiques directes et indirectes des grandes expositions organisées ces dernières années.
Le rôle
essentiel des musées de territoire
Les musées ont toujours occupé une place majeure dans l'offre touristique. Ce sont à la fois des lieux de conservation et de connaissance, mais aussi de plus en plus souvent, des vitrines et des sites d'interprétation qui "expliquent" un sujet, en proposent une explication sous forme d'expositions permanentes ou temporaires, mais donnent aussi à lire un territoire en proposant une découverte sous forme d'une muséographie "diffuse" dont l'exemple français des écomusées reste parfaitement démonstratif.
Bien entendu le succès des musées est à l'égal du succès des sites patrimoniaux. Les institutions muséographiques des centres villes restent privilégiés en terme de fréquentation (5,7 millions de visiteurs au British Museum de Londres en 1995, aux alentours de 5 millions pour le Louvre dans les années récentes - alors que le chiffre se situait autour de 1,5 millions au début des années quatre-vingt, près d'un million pour les Galeriesdes Offices à Florence).
Les musées des pays d'Europe centrale et orientale n'étant pas en reste, même si le phénomène est plus récent : plus d'un demi million de visiteurs à la Galerie Nationale de Prague à la fin des années quatre-vingt dix.
La récente réunion à laquelle nous avons assisté à Florence en 2003 nous semble par contre parfaitement indicative de l'évolution majeure qui est en train de se dessiner et qui dans le cas présent a été clairement provoquée par une baisse significative de la clientèle américaine depuis deux ans.
Les notions de petits - grands musées, "museo del territorio" (Antonio Paolucci) "museo diffuso" (Elisabetta Del Lungo) cherchent à mettre en œuvre un ensemble de propositions qui renvoient les touristes vers une diffusion et une visite territoriales, à partir des "grands" musées surchargés.
On souhaite ainsi souligner que des œuvres également majeures peuvent être tout autant découvertes dans des musées régionaux, provinciaux ou locaux, avec l'avantage d'une immersion dans un territoire et son paysage et en confrontation directe avec ses produits.
Mais cela permet également la mise en réseau de musées scientifiques ou des propositions concernant des artistes : itinéraire de Piero della Francesca ou Leonardo da Vinci (4), par exemple. Cette démarche fait dorénavant l'objet d'un plan de financement important sur trois ans, complémentaire aux subsides de la Région, par la Cassa di Risparmo di Firenze.
L'importance
des phénomènes événementiels et des célébrations - les personnages européens
Tous les pays européens en sont venus à la mise en œuvre de célébrations nationales : bicentenaire de la Révolution française, millénaire hongrois, ainsi qu'à la célébration de personnages historiques fondateurs, de grands écrivains, d'artistes ou musiciens anciens (Anniversaire de Victor Hugo, de Mozart - qui a donné l'objet à un itinéraire culturel -) voire contemporains : le cas en 2003 de Jacques Brel ou de Simenon en Belgique.
Là encore les opérateurs touristiques sont de plus en plus souvent associés à la démarche. En ce qui concerne les personnalités, nous avons été conduits à consacrer une partie de notre site web à cette question, dans la mesure où un personnage d'ampleur européenne peut devenir un thème structurant au plan régional si on sait quitter le domaine anecdotique pour celui de l'interprétation.
Si l'on prend en compte d'abord les valeurs européennes, le choix des personnages n'en reste pas moins complexe, que ce soit en positif ou en négatif ou avec l’ambiguïté de lectures divergentes.
Par exemple, doit-on mettre d’un côté Luther ou Voltaire et de l’autre Hitler, Staline et Napoléon ? (5)
De plus, l'utilisation souvent simplifiée qui en est faite lors des célébrations nationales, dans le cadre imposé des programmes scolaires ou dans celui du tourisme fondé sur des routes historiques ou des maisons musées, pour ne citer que quelques exemples, rend nécessaire de mettre en œuvre des choix rigoureux.
C’est dans ce domaine de la médiation en direction du public mais aussi toujours dans celui du tourisme culturel qu’on peut se pencher sur le rôle des centres d’interprétation. Que ceux-ci reposent sur des expositions permanentes ou ponctuelles, des lieux documentaires traités d’une nouvelle manière, tournés vers un large public ou vers des publics ciblés, ils présentent un intérêt certain.
Ils constituent un outil complémentaire des «maisons musées», lieux d’habitation ou de séjours passagers de personnages historiques, de personnalité du monde des lettres et des arts.
Ces centres constituent aussi un complément des monuments historiques, palais ou châteaux représentatifs de l’histoire nationale, liés à des famille ou à des personnages illustres. Tout comme le ferait un livre, autour d’un sujet central qui sert de fil conducteur, ils permettent le jeu des correspondances, des analogies, des thématiques croisées.
Figures et personnages peuvent êtres ces «fils rouges», qui servent de guide pour mettre en évidence l’un ou l’autre visage de l’Europe. On voit bien comment imaginer des centres d’interprétation qui auraient pour sujet un personnage comme Victor Hugo, ou comme les fondateurs des institutions européennes (Route Schuman à Luxembourg), ou au contraire autour des figures issues de mythes fondateurs, comme celles d’Ulysse et d’Enée par exemple (6), ou autour de grandes familles européennes à travers un ou plusieurs personnages de ces familles.
Cliché MTP.
Les
problématiques de la valorisation et de l'interprétation
Le tourisme de tous les
dangers
Si le tourisme de masse constitue un danger pour le patrimoine, le tourisme qui prend pour objectif la pratique culturelle comme un moyen - à priori nouveau - de gagner une part de marché, est par essence le tourisme de tous les dangers.
Ces dangers tiennent aux fortes contradictions qui le traversent. En effet, en dehors des professionnels du tourisme sans qui la mise en œuvre de tels produits n'existerait pas ou qui seraient confinés à de simples démarches individuelles, un ensemble de partenaires participent à l'élaboration de l'offre, entre autres les professionnels de la culture, les associations culturelles, les responsables publics et les élus, qui les uns et les autres, expriment par nature des souhaits contradictoires.
D'un coté, il s'agit de la recherche du respect et de l'intégrité des faits culturels, de la nécessité de respecter les chartes et les conventions sur la protection et la valorisation du patrimoine, de la volonté d'un aménagement culturel équilibré et durable du territoire, ce qui implique une longue analyse préalable et des investissements coûteux.
Mais il s'agit aussi de l'implication d'actions sociales et éducatives qui fassent en sorte que les "visités" participent eux aussi à la constitution de l'offre, pour qu'elle soit à la fois le reflet de leur identité passée, sans "folklorisation" et de leur réalité sociale actuelle, sans exclusion.
On ne montre pas un patrimoine de manière innocente, d'autant moins lorsqu'il est lié à un passé récent et parfois douloureux.
De l'autre, on tendrait plutôt à privilégier les lois du marché en instrumentalisant la culture vers ses avatars les plus attractifs, en choisissant une offre de loisirs qui satisfasse le plus grand nombre au sein de parcs de loisirs ou à thèmes, dont tous n'ont pas trouvé leur public.
Ou bien, à l'opposé, on recherche des manifestations de prestige réservées à une élite et, en établissant un partenariat économique tourné vers la priorité de l'équipement de luxe on restaure châteaux et villas, jardins et résidences pour recréer le "charme du passé".
Le contexte économique et social du tourisme culturel révèle donc de véritables fractures. La responsabilité prise par les opérateurs qui mettent en œuvre des produits de tourisme culturel est très grande et les risques se situent à plusieurs niveaux :
- celui de la restauration et de la conservation qui se doit de respecter
les documents historiques et les chartes internationales;
- celui de l'interprétation qui doit éviter de tomber dans l'anecdotique
ou l'ethnocentrisme et au contraire, offrir au public une dimension
multiculturelle;
- celui du rôle social et économique du tourisme qui doit générer des emplois locaux, trouver aux équipements un rôle qui s'étende au-delà des moments privilégiés de la fréquentation touristique et qui doit, enfin, permettre à une population de faire sienne l'identité ou les identités qu'elle présente d'elle-même.
Le tourisme culturel est donc en passe de devenir de ce fait un des lieux privilégiés des contradictions de la société qui le met en œuvre et un des signes les plus tangibles de sa "santé culturelle".
Il reste certainement à écrire une "Allégorie du tourisme culturel", après "L'allégorie du patrimoine" de Françoise Choay.
Le cas particulier du tourisme de mémoire
Si il est une tendance importante qui se développe en région en ce qui concerne le tourisme culturel c'est bien le "tourisme de mémoire". Il semble logique que dans la mesure où l'Europe retrouve des bases plus large et que les visiteurs et les touristes peuvent de nouveau franchir des frontières autrefois plus drastiques, la question des conflits dramatiques qui ont déchiré le continent les préoccupe.
Au même titre que le patrimoine industriel devient une clef de lecture d'une organisation sociale en voie de disparition, les lieux de mémoire constituent autant d'hommage aux disparus et aux sacrifiés de l'Europe du XXe siècle, tout comme un moyen de coopération transfrontalière entre les pays et les régions d'Europe qui ont un travail de mémoire à réaliser ensemble pour construire un nouveau continent de dialogue, de paix et de démocratie.
Un
tel travail doit certainement être entrepris par les Régions en s'adressant de
manière privilégiée aux jeunes Européens.
"Les plages du débarquement de juin 1944 et Verdun sont parmi les lieux les plus visités. Chaque année, près de 500.000 personnes se rendent à l'ossuaire de Douaumont, dans la citadelle souterraine ou dans les forts de Douaumont et de Vaux. A Rethondes (Oise), ce sont quelque 120.000 curieux, dont plus de la moitié d'étrangers, qui viennent voir la réplique du wagon où furent signés les armistices de novembre 1918 et de juin 1940. Le 11 juillet 2002 un lieu symbolique a été ouvert au public. Il s'agit du Simserhof, un des plus grands ouvrages de la ligne Maginot, ensemble de fortifications édifié entre les deux guerres mondiales. L'ancien musée a été repensé pour laisser place à un "parcours spectacle" cheminant en wagonnets sonorisés et à 30 mètres sous terre avec projections de vidéos, effets spéciaux, cinéma et cafétéria. Dans ce projet d'un montant de 7 millions d'euros, le Conseil Général de la Moselle apporte 5,18 millions, la Commission Européenne 7 millions, la région Lorraine et l'Etat 910.000 Euros chacun. Certaines régions sont moins empressées de faire découvrir leurs lieux de mémoire. C'est par exemple le cas du Languedoc-Roussillon, où les camps d'internement de Rieucros (Pyrénées-Orientales), construit en 1940 et où furent successivement détenus des républicains espagnols, des Allemands après la Libération, puis des harkis au lendemain de la guerre d'Algérie, ne peut guère être envisagé comme un argument promotionnel…A l'inverse, certains lieux de ce circuit de la mémoire s'emploient à élargir leur apport. Ainsi l'historial de Péronne (Somme), au-delà de la guerre 14-18, mène pour ses 80.000 à 85.000 visiteurs annuels une réflexion sur "la violence de la guerre" en général, avec des expositions sur le conflit de Bosnie ou des tapis Afghans, tandis qu'en Normandie le Mémorial de Caen accueille depuis 2002 des armements témoins de la guerre froide." rapporte le journal Le Monde en mars 2002.
L'Institut Européen des Itinéraires Culturels a engagé depuis sa création une réflexion sur la place et l'importance de la mémoire dans la relecture de l'histoire et du patrimoine de l'Europe.
Il s'agit bien d'une démarche politique, car il est nécessaire de faire participer, par l'analyse et le travail commun, les acteurs et les itinéraires culturels à l'intégration des notions d'oubli et de pardon, ainsi que de partage de la mémoire entre l'Est et l'Ouest de l'Europe.
Dans la mesure où la mémoire constitue une dimension, voire une problématique, qui traverse depuis plusieurs années tous les thèmes traités par le programme des itinéraires, elle devrait constituer l'un des moyens de relecture du programme et donner lieu à une analyse appropriée du terme et de ses concepts.
Nous pensons en effet, en nous appuyant par ailleurs sur les nombreux travaux entrepris par le Conseil de l'Europe, que ce cadre est un outil directement lié à l'apprentissage de la démocratie et de la conscience civique et qui, de plus, aide de manière concrète et exemplaire à la prévention de nouveaux conflits.
Une mise en réseau des actions existantes qui parlent de mémoire - et font parler la mémoire - doit donc être effectuée pour que ce début de réflexion puisse s'enrichir. En effet, beaucoup de réunions organisées ou coorganisées par l'Institut ces dernières années ont touché de près ou de loin à cette question, en faisant appel à des experts de disciplines complémentaires : colloque « Patrimoine et mémoire : des projets pour vivre ensemble » (Sibiu,1999), colloque de Saint-Jacques de Compostelle sur "Les valeurs culturelles de la citoyenneté européenne" en 2000 à la demande du Grand-Duché de Luxembourg. ( 7)
Engager une réflexion sur la mémoire nous apparaît aujourd'hui également comme une priorité parce que, à côté et souvent au-delà des dimensions historiques et patrimoniales, un grand nombre de propositions qui nous sont faites pour de nouveaux thèmes ou de nouvelles actions incluent également cette dimension, sans toujours en proposer une analyse à priori.
Un rétablissement des continuités entre des histoires souvent fragmentées et donc incomplètes doit permettre une relecture du passé qui nous lie les uns aux autres, et pourquoi pas amener à un travail en commun sur une histoire de l'Europe des itinéraires culturels et non plus des histoires et des parcours exclusivement étudiées d'un point de vue national.
C'est la mixité des courants interculturels qui se croisent sur notre continent qui crée par leur complexité le sentiment d'appartenance à une communauté européenne. Il faut rappeler combien les différents épisodes constitutifs des histoires nationales peuvent être appréhendés comme un patrimoine commun, y compris les patrimoines de la souffrance.
L'Institut Européen des Itinéraires Culturels et ses partenaires veulent donc contribuer à cette prise de conscience et concourir à ce que tout citoyen européen s'approprie des événements et les vive comme une mémoire partagée.
Il apparaît que les leçons du passé n’ont pas été suffisamment mises en lumière, ni suffisamment assimilées par la conscience européenne. Il est donc nécessaire de fournir un effort, et notamment en direction des jeunes, pour que tous réalisent l'importance de cette relecture pour mieux comprendre la société contemporaine, tout comme pour se projeter dans un avenir commun. En cela, nous nous accordons avec Raymond Weber pour répondre par l'affirmative à sa question :
"Ne devrions-nous pas essayer… de proposer aux citoyens européens, et notamment aux jeunes, une lecture de notre histoire et de nos civilisations et cultures (…) qui nous montre, certes, dans toute notre diversité culturelle, mais aussi dans notre volonté d'avoir en commun non seulement un patrimoine, mais aussi une visée et un projet sur l'avenir ?".
A la suite des recommandations des experts que nous avons réunis, le travail sur la mémoire de l'Europe entrepris par l'Institut ne concernera qu'une période restreinte de notre mémoire mais une période qui justement est à portée de notre mémoire.
Il mettra l'accent sur les cent cinquante dernières années de notre histoire, depuis la signature des grands traités qui ont contribué à découper l'Europe et créé les Etats-Nations. C'est au cours de cette période que se sont opérées certaines des transformations les plus profondes de nos sociétés : passage de la société traditionnelle rurale à la société urbaine, passage de la société artisanale à la société industrielle puis déclin de dernière au profit de la post industrie. C'est aussi la période qui est - en effet - à portée de notre mémoire, celle des générations qui nous ont juste précédé, nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents.
L'importance de l'interprétation et du message en termes européens.
La rédaction du message patrimonial destiné aux touristes reste une étape essentielle dans le cadre de ce que les professionnels nomment "la mise en tourisme". La nature de ce message a largement évolué depuis un siècle et demi, passant de l'ethnocentrisme, du régionalisme et du nationalisme à la mise en avant des valeurs d'échange.
Les textes des guides touristiques imprimés, des dépliants des opérateurs réceptifs, des panneaux descriptifs, et maintenant ceux des bornes interactives et des produits multimédias, tout comme l'argumentaire commercial des opérateurs touristiques sont cependant autant d'indicateurs de cette évolution qui n'est pas terminée.
Là encore les Régions ont un rôle de médiateur extrêmement important dans la mesure où elles sont en dialogue permanent avec d'autres Régions d'Europe.
Approche marketing…
Parmi tous les analystes du marketing touristique que nous avons rencontrés au cours des dizaines de réunions sur ce sujet auxquelles nous avons participé, Anthony S. Travis, Enseignant à l'Université de Birmingham a présenté à Gdansk en octobre 1997, colloque dont nous avons publié les Actes (8), une vision particulièrement sincère intitulée : "Le tourisme patrimonial - nouvelle technique de mise en valeur d'un lieu de destination". Il décrit sans fards le fondement d'une politique d'image autour de ce qui reste pour lui avant tout une industrie :
"Le tourisme patrimonial a besoin de connaître l'art de fabriquer une image, en faisant appel à des symboles, à des éléments physiques et à des événements pour renforcer ce je-ne-sais-quoi qui fait que Stockholm est Stockholm, Dantzig est Dantzig, Riga est Riga, etc. Si la Tour Eiffel est l'icône de Paris, et un théâtre d'opéra et un pont celle de Sydney, quelle image ou quel symbole pourront servir à identifier et à vendre votre ville ? Le tourisme patrimonial est une industrie, et si vous lancez une "nouvelle" destination sur le marché du tourisme international, cela signifie qu'il vous faudra assembler toutes les pièces du produit touristique, c'est-à-dire lier et vendre ensemble non seulement les transports et les arrangements hôteliers, mais aussi les réservations pour assister aux festivals et autres manifestations, les billets d'entrée des musées, les visites des sites historiques, les dîners où l'on goûtera aux plats d'une cuisine du passé, le tout faisant partie d'une offre globale vendue à l'avance.
C'est ainsi que
pourront être offertes aux clients des expériences de grande qualité,
lesquelles pourraient avoir un goût de "revenez-y"…"
Il est vrai que les données économiques liées à une telle analyse sont à prendre en compte.
L'Europe représente 60% des arrivées internationales. La France accueille à elle seule chaque année 60 millions de touristes. L'impact des retombées économique du Mont-Saint-Michel et de la cathédrale de Chartres ont été mesurés en 1985 respectivement à hauteur de 24 et 38 millions d'euros.
Andreas Hassler et Risto Hemming de ProNord GmbH, spécialistes du tourisme émetteur en Allemagne indiquaient au cours du même colloque à Gdansk :
"Quelque 50 milliards de dollars sont dépensés chaque année par les Allemands à l'étranger. Il existe 18000 agences de voyages et un millier de voyagistes et les quatre principaux voyagistes représentent 60% du marché…" Pour ajouter : "Une vingtaine de voyagistes seulement peuvent être considérés comme des spécialistes du tourisme patrimonial".
Et il proposait lui aussi quelques recettes pour améliorer cette situation, recettes qui mettent là aussi très clairement le message au service de l'ingénierie :
"Si nous voulons vendre le tourisme patrimonial avec des chances de réussir, il faut lui donner une définition très large, ainsi qu'une apparence dynamique susceptible de plaire aussi aux jeunes par l'âge ou jeunes de cœur. Les éléments du patrimoine doivent être modelés et présentés comme des produits : ils doivent avoir un prix et les voyagistes doivent être capables de les traiter comme un Bausteine distinct susceptible d'être incorporé dans les programmes ; il en est de même pour le voyageur indépendant : il doit avoir la possibilité d'acheter, et le cas échéant de réserver le produit.
Fondamentalement, c'est encore une fois une question de coopération et de compréhension de ce qui est attendu des joueurs. Nous avons tous ici nos rôles et nos tâches : les régions, les pays, les voyagistes, les spécialistes du marketing, etc. Ou pour le dire encore plus simplement, l'industrie touristique d'un coté et le secteur culturel de l'autre."
…versus message patrimonial
Tout aussi frappante était en avril 2000 la remarque du Directeur auprès du Commissariat général au tourisme wallon, Eric Jurdant lors de la réunion préparatoire au Sommet de la Grande Région. Sa présentation faisait bien la transition entre le marché et le message, en terme d'identité :
"Il est évident que je serai un
touriste cible d'autant plus facile à capter si une opération marketing de
charme me convainc que je partage une histoire commune avec mes voisins
immédiats de Sarre, de Rhénanie-Palatinat, du Grand-Duché de Luxembourg, de
Lorraine ou de Wallonie. Si généralement, c'est la différence culturelle qui
motive le déplacement touristique, ici, notre démarche va à contre courant :
notre souhait est de faire prendre conscience d'une identité commune grâce au
tourisme. Mais cette identité comporte, heureusement, un élément d'exotisme, la
présence de deux langues."
En fait lorsque les responsables du patrimoine d'une ville ou d'une Région s'adressent à leurs collègues responsables du tourisme, ce qui n'est pas toujours facile, ils mettent en avant une notion essentielle : le message patrimonial c'est d'abord une question d'authenticité.
D'abord l'authenticité de la substance même, car l'objet est par lui-même le meilleur message.
"Aujourd'hui, la pression exercée par le tourisme a souvent pour résultat que l'œuvre est refaite et perd ainsi son authenticité, or l'authenticité du patrimoine est constitutive de son identité. Il faut donc à tout prix éviter cette dérive qui conduit à créer des faux historiques et à induire le public en erreur parce que le patrimoine présente un aspect qu'il n'a jamais eu…" affirme Catherine Périer d'Ieteren.
Ensuite, l'authenticité du discours. Catherine Bertho Lavenir remarque avec justesse :
"C'est un plaisir pour des millions de gens de faire du tourisme, même si c'est pour simplement arpenter des lieux célèbres, admirer la tour de Pise et la tour Eiffel. Il serait sot de ne pas s'appuyer sur cette dynamique. En revanche, il est nécessaire de demeurer vigilant.
Longtemps les éléments du patrimoine ont été utilisés pour montrer combien une communauté - nationale, ethnique, religieuse - était différente de ses voisines, irréductibles à elle, et, de ce fait, pour légitimer ses combats."
Importance en termes quantitatifs : histoire et présent
De nombreux livres, tels que - pour ne citer que la littérature française la plus récente - l'ouvrage collectif publié sous la direction de Alain Corbin en 1995 "L'avènement des loisirs 1850-1960", "Tourisme culturel en France et en Europe" de Valéry Patin (1997), "Réinventer les vacances. La nouvelle galaxie du tourisme" ouvrage coordonné par Jean Viard en 1998 ou enfin "La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes" de Catherine Bertho Lavenir (1999) reviennent longuement sur l'origine du phénomène, des guides de la Grèce, aux récits de voyage des explorateurs, de la vogue des stations thermales, à la fascination du rivage et des espaces purs des montagnes pyrénéennes et alpines et y ajoutent pour la France, voire pour l'Europe, un ensemble de statistiques.
L'histoire du tourisme est ponctuée de révolutions qui reposent toujours sur de nouveaux médias : les médias écrits, les moyens de transport et bien entendu aujourd'hui les médias informatiques.
L'importance
des médias : guides et moyens de transport
De manière symbolique, c'est une invention du milieu du XVIème siècle qui a changé la vision et la préparation du voyage. La publication de "La guide des chemins de France" - le terme étant féminin à l'époque - par Charles Estienne en 1552, ouvrage suivi des "Fleuves du royaume de France" et des "Voyages de Rome, de Saint Jacques et de Jérusalem" a constitué une étape essentielle.
Ces guides constitueront des modèles pour des ouvrages portatifs permettant au voyageur de retrouver son chemin, de choisir ses gîtes d'étapes et de se prémunir contre les dangers susceptibles d'être rencontrés au cours du voyage. On peut dire qu'ils engendreront la génération suivante des grandes collections de guides européens, ceux du XIXème siècle, qui proposeront bien plus que des renseignements pratiques.
Ils chercheront véritablement à éduquer le regard par un langage codé et des repères esthétiques fondés sur "les merveilles naturelles" et les "haut lieux de l'architecture civile et militaire" qui "méritent le détour" ou constituent des "points de vue exceptionnels" et à imposer des parcours et des itinéraires emblématiques, ainsi que la visite des musées et des sites patrimoniaux aménagés dont le nombre progresse au cours du siècle avec une volonté affirmée de conserver et de valoriser le patrimoine "national".
A la fin du XIXe siècle, les loisirs populaires sont plutôt tournés vers le sport ou la pêche, tandis que les voyageurs curieux restent des aristocrates et des rentiers qui suivent le rythme des saisons au bord de la mer ou à la montagne et lancent la vogue des clubs alpins, des croisières et des voyages en trains de luxe.
Les tournants
du XXe siècle
Il faut par contre attendre l'une des conquêtes du Front Populaire français et d'autres mouvements européens comparables dans les années trente, pour que se déclenche un phénomène qui se poursuit encore aujourd'hui, celui du tourisme populaire et de ses conséquences sous forme du tourisme de masse.
Les formules d'accueil de ces nouveaux touristes, disposant
de congés payés, se sont ajoutées les unes aux autres. Elles ont d'abord été
caractérisées par une prise en charge communautaire : Auberges de jeunesse,
centres de vacances des comités d'entreprises, villages et clubs vacances et
par des critères d'économie : "bed and breakfast", chambres d'hôtes, tourisme à
la ferme…
Mais ce tourisme populaire, devenu un tourisme de masse, traité par les acteurs économiques à l'égal d'autres industries, n'a pris cet essor fantastique qu'en raison de l'amélioration considérable de la vitesse des moyens de transport, depuis la vogue des trains de plaisir, en passant par celle de l'autocarisme, jusqu'au succès des vols charters d'aujourd'hui.
"Il y a deux siècles encore, nos ancêtres jugeaient les montagnes horribles et les bords de mer inquiétants. Seuls les vagabonds marchaient et couchaient en plein air. On ne voyait guère que des charrettes sur les routes, et personne ne se souciait des monuments et des sites. Et puis sont apparus d'abord la bicyclette, ensuite l'automobile, et avec elles le tourisme moderne" affirme Catherine Bertho Lavenir. Ce comportement social nouveau a été lui même porté à son apogée à partir des années soixante par la grande vogue du "sea, sex and sun".
Toutefois cette présentation de l'évolution du voyage européen mérite d'être nuancée lorsque l'on s'adresse à l'ensemble de la Grande Europe. Les étapes les plus proches de cette évolution sont singulièrement différentes si l'on considère l'Ouest et l'Est.
Les séminaires auxquels nous avons participé, tout comme les demandes qui nous sont faites par les pays de la C.E.I ou du Caucase, voire ceux de l'Asie centrale (9) situés sur les Routes de la Soie (1999) témoignent d'une volonté récente d'ouverture, mais également du souhait de participer à la manne touristique et de récupérer une partie des 3.000 milliards d'euros dépensés dans le monde chaque année par les voyageurs.
Extension du tourisme culturel vers le Centre et l'Est de l'Europe
Après une période où le tourisme culturel s'est
essentiellement porté sur les grandes villes de l'Est réouvertes sans
difficulté majeure - et bientôt sans visa - aux touristes de l'Ouest européen :
les cas de Berlin, Prague, Budapest et Cracovie sont certainement à citer de manière privilégiée
et figurent pratiquement dans tous les catalogues des opérateurs touristiques,
on assiste à une lente montée de nouvelles destinations à la suite d'un travail
diffus d'aménagement de territoires quasiment vierges.
Le cas des régions et des villes de la Mer Baltique est certainement le plus remarquable dans la mesure où les Pays Baltes ont été très vite invités au sein des organisations touristiques. On peut même affirmer qu'un esprit proche de celui du réseau ancien des Villes de la Hanse a très vite prévalu. Si on y ajoute le fait que plusieurs villes et parcs naturels ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial et que les organisations ont pris pour thème des thématiques des itinéraires culturels : les Vikings, les sites et villes hanséatiques, les forteresses…on comprendra pourquoi l'Institut dispose de réseaux actifs et d'informations détaillées sur les Pays Baltes.
Mais nous devons citer aussi le travail entrepris avec les branches nationales de l'ICOMOS des pays des Balkans qui a abouti à un partenariat avec l'Université de Sofia pour la mise en œuvre des itinéraires culturels du Sud-Est européen.
Le cas des itinéraires dans l'espace rural du nord de la Roumanie, ou en Transylvanie où les touristes hongrois et allemands sont maintenant très présents, des villes baroques hongroises, lituaniennes, ukrainiennes, slovènes ou croates, des routes de la soie en Roumanie, en République de Moldova, en Géorgie…voire des coopérations transfrontalières entre régions hongroises et slovaques fait également l'objet de partenariats actifs avec l'Institut.
Peu à peu l'Institut dispose donc d'un réseau de partenaires nationaux, régionaux et locaux qui lui donnent une vision permanente sur cette évolution qui ne saurait que se développer et qui devrait même constituer le fait le plus important de l'évolution du tourisme européen dans ce début du XXIe siècle.
Statistiques
économiques nationales et régionales
Un domaine économique très spécifique
"La prise en compte du tourisme comme moyen de valorisation économique du patrimoine est un phénomène relativement récent. Durant de longues années, l'économie du patrimoine culturel s'est en effet limitée à une évaluation des flux financiers et des emplois liés à la restauration des monuments historiques ou objets mobiliers ainsi qu'aux actions de réhabilitation et de réutilisation du bâti ancien. Cette orientation n'a pas disparu mais elle s'est trouvée reléguée au second plan par la naissance d'une économie touristique du patrimoine essentiellement fondée sur l'exploitation des sites culturels et naturels." écrit Valéry Patin en 1997.
Il s'agit là
d'une remarque qui indique bien que l'esprit des aménageurs et des agents de
développement a prévalu sur celui des conservateurs. Des sociétés d'économie
mixte se sont ainsi développées entre collectivités publiques - propriétaires
des sites et des musées - et les
opérateurs privés, dont les agents économiques liés au tourisme. Ces
derniers qui pèsent de manière très importante en termes d'emplois se sont
d'ailleurs constitués en groupements professionnels locaux et nationaux et
travaillent régulièrement auprès de la D.G. XXIII de l'Union Européenne pour
l'amélioration de leurs conditions de travail et la reconnaissance de leur rôle
économique essentiel.
Ceci à tel point que l'Unité Tourisme de la D.G. XXIII de l'U.E. a pratiquement restreint ses axes de travail à la question de l'emploi, en abandonnant depuis 1998 toute velléité de recherche d'un plan commun pour l'amélioration de l'image de "La destination Europe".
Il est vrai que des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ont souhaité que dans ce domaine d'une image commune, la Commission respecte les règles de subsidiarité et laisse les pays membres entièrement libres de leur propre politique.
En ce qui concerne les chiffres on doit rester extrêmement prudent. La valeur économique du patrimoine a fait l'objet de très peu d'études, contrairement au reste du marché des industries culturelles.
Pour citer Xavier Greffe :
"Les objets de la demande et de l'offre de patrimoine ne se confondent pas. La demande est au départ une demande de "services" d'ordre esthétique, artistique, cognitif, économique etc., services qui supposent en général un début d'aménagement du bien patrimonial considéré, quelquefois même son réaménagement complet. L'offre est au départ l'offre d'un "support" qui ne produit a priori qu'un seul service, le droit de regard ou, à la limite, le droit de visite; elle ne devient offre de service et n'entre en adéquation avec la demande que si le détenteur du capital entreprend de l'organiser."
Si on peut produire une analyse économique des aménagements, il est difficile d'en faire de même pour ce qui concerne les biens intangibles et les espaces naturels, voire le patrimoine immatériel.
S'y est ajoutée bien entendu récemment la notion de développement durable qui fait que la composante économique des aménagements doit être inscrite dans une opération non seulement de partage des profits, mais de participation des acteurs locaux aux fruits de l'investissement collectif, et ceci à long terme.
Dans ce cadre les parts des dépenses pour le patrimoine et les musées entre les Etats, les communes, les départements et les régions est extrêmement variable selon les pays.
Une seule règle - double - semble prévaloir, celle du désengagement progressif des Etats et d'une amélioration des avantages fiscaux accordés au secteur privé. En France en 1993, les Régions assumaient 12,6 % des dépenses en matière de patrimoine et 7,2 % pour ce qui concerne les musées.
Le cas italien du Fondo investimenti occupazione qui régit depuis 1982 l'ensemble du territoire à l'exception du Mezzogiorno devrait être examiné de plus près. Le système de la loterie britannique constitue un autre modèle intéressant. S'y ajoutent bien entendu le rôle fondamental des Fonds structurels européens, des programmes Leaders et interreg, ainsi que des programmes d'aides spécifiques Phare et Tacis pour les Pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que, depuis quelques années de manière ponctuelle, mais significative, le programme Culture 2000.
Des analyses plus détaillées en termes de montages financiers entre les différents partenaires publics et privés, nationaux et territoriaux ont été réunies par l'Institut à l'occasion de la mise en valeur culturelle et touristique de certains itinéraires. Elles peuvent être mises, en tant que modèles, à la disposition des Régions qui le souhaiteraient, mais nous avons acquis le sentiment que - compte tenu de la complexité des facteurs culturels et patrimoniaux mis en œuvre - chaque cas reste très spécifique et doit faire l'objet d'une "étude à la carte".
On peut également consulter les données réunies par l'Organisation Mondiale du Tourisme, l'OCDE (Politique du tourisme et tourisme international dans les pays membres de l'OCDE) celles de l'Agence Française d'Ingénierie Touristique (AFIT), de l'ICOMOS ou de la DG XXIII, Unité tourisme de la Commission européenne qui a en particulier consacré trois études aux bonnes pratiques dans le domaine du tourisme urbain, rural et de montagne. Chaque pays, chaque région et chaque département publie également un compendium annuel où on peut trouver des informations chiffrées utiles.
L'Institut en possède un certain nombre à titre d'information et en relation là aussi avec des projets précis. Une des meilleurs analyses concernant précisément le tourisme culturel a été produite par la Région Lombardia en 1993. Le travail a été effectué sous la direction de Carla Bodo.
Mais il est clair que si les analyses nationales sont encore peu nombreuses et restent marginales au sein des statistiques générales du tourisme, beaucoup reste à faire pour donner une meilleure image de ce secteur économique dans ses composantes régionales, en tenant compte encore une fois d'un modèle de fonctionnement qui n'a pas d'équivalent dans les autres secteurs productifs.
Il n'existe à notre connaissance que des données éparses en provenance des différents observatoires des politiques culturelles dont les domaines d'étude privilégiés sont d'abord les différentes disciplines artistiques et les pratiques culturelles, en laissant de côté les pratiques "patrimoniales et touristiques" qui sont au cœur de notre sujet. On peut cependant trouver quelques repères dans les rapports qui ont fait suite aux analyses des politiques culturelles et patrimoniales des pays européens menées par le Conseil de l'Europe.
Réunion européenne sur l'itinéraire culturel de l'habitat rural. Andorre, Bulgarie, Luxembourg. Roumanie. IEIC, Octobre 2002.
Observatoires
touristiques et agences d'ingénierie touristique
Si les statistiques économiques sont rares, par
contre le fait même du tourisme culturel a suscité beaucoup plus de travaux, ce
qui permet de se faire une idée assez précise de son importance et surtout de
la nature des "touristes culturels".
Parmi tous les analystes de la montée du tourisme culturel, Greg Richards est certainement l'un des experts qui a réuni avec son équipe le plus grand nombre de faits soutenus par des études statistiques. Depuis la reconnaissance par la Commission Européenne en 1990 du tourisme culturel comme un segment en croissance des marchés touristiques, il s'est vu confié une série d'études dans le cadre de l'"European Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS)".
Des rapports ont été fournis en 1996, en restant propriété de la Commission, mais Greg Richards est régulièrement intervenu lors de réunions organisées par l'Institut seul ou en coopération avec des opérateurs publics ou privés (Ville de Venise, Société Provinciales, Fondation Caja Rioja, Ville de Manchester…). Il y a donc donné un résumé très général de ses études.
Greg Richards. Cliché MTP.
L'étude de 1996 est fondée sur le questionnement de 6500 visiteurs dans 26 sites de neuf pays différents. L'étude a été répétée en 1997 aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Finlande, en Irlande et au Portugal. Elle a été complétée depuis à la demande de certaines villes, comme Barcelone qui prépare une grande opération culturelle et économique pour l'année 2004.
Les données les plus évidentes doivent être soulignées de nouveau :
Les "touristes culturels" sont des personnes de niveau scolaire élevé disposant de revenus également élevés, ce que l'on nomme "new middle class" et correspondent au profil sociologique de Pierre Bourdieu pour lequel la consommation est un signe de distinction. (Revenus annuels de 30.000 Euros ou plus en 1997).
Contrairement à une opinion courante, plus de 30% d'entre eux ont moins de 30 ans (11% ont un statut d'étudiants). Le record étant même atteint par les touristes français (40%). Ils recherchent à approfondir les connaissances acquises à l'école et 36% d'entre eux sont des touristes dont les activités de loisirs restent exclusivement centrées sur le domaine culturel.
En terme de lieux de visite on retrouvera sans s'en étonner les grandes villes déjà citées dans ce rapport. Parmi les facteurs de distinction les mots "atmosphère" et "authenticité" sont les plus souvent cités.
A ces chiffres nous devons ajouter quelques données réunies à l'occasion du récent séminaire de Florence. En ce qui concerne la Toscane, les chiffres de l'année 2000 indiquent que parmi les touristes intérieurs, 18,2% indiquaient être venus pour "des raisons culturelles". Cette proportion atteignait 30,2 % pour les touristes étrangers, quel que soit leur pays d'origine.
Le Directeur du Touring Club italien qui vient de lancer un programme intitulé "La péninsule du trésor" estime à 25,5 % la part du public ayant des motivations essentiellement culturelles.
Comme on peut le constater, si les analyses économiques générales et spécifiques sont rares, le fait que le modèle correspondant au tourisme culturel et patrimonial est inhabituel - et relativement récent - induit une simple vérification statistiques de données intuitives sur la nature des publics.
L'Institut n'a pas la mission, ni même la capacité de pratiquer une analyse statistique comparable à l'échelle de la Grande Europe. Il joue plutôt le rôle d'un observatoire des modifications de comportements des touristes, au travers de grands espaces de découverte comme les chemins de pèlerinage, par les touristes, visiteurs ou pèlerins qui lui font parvenir des courriers en grande quantité.
Mais il procède à une écoute plus spécifiques des opérateurs publics et privés en enregistrant leurs projets et en cherchant à les aider à les mener à bien.
Plusieurs faits sont clairs : ces projets sont en accroissement constant dans toute l'Europe. Ils manquent en général de cohérence à l'échelle européenne. Mais ils témoignent d'un changement complet d'attitude face au patrimoine, à la fois dans l'extension des typologies présentées, dans la variété des projets présentés et dans la volonté d'une coopération entre collectivités de même nature à des distances éloignées.
Autrement dit, le sujet importe plus que la proximité territoriale. En témoignent les réseaux Est-Ouest que nous avons montés.
Il nous semble de plus que les Régions possèdent en général leurs propres observatoires économiques et, leurs représentations auprès de l'Union Européenne ont également un rôle d'observatoire économique. Ce que l'Institut pourrait apporter aux Régions, ce sont avant tout des analyses concrètes et comparatives sur les bonnes pratiques, en les appuyant sur une coopération avec ces observatoires.
Chiffres et évolution sociologique
Selon les experts que nous avons rencontrés, le tourisme culturel doit donc représenter aujourd'hui de 8 à 20% des parts du marché touristique.
Mais certains d'entre eux considèrent assez justement que "La culture est un phénomène tellement large et complexe qu'une définition claire du "tourisme culturel" en devient impossible et peut même s'avérer inutile." (Tomasz Studzieniecki).
C'est donc plutôt un choix personnel et pratique qui guide chaque touriste dans la recherche d'un investissement culturel personnel et d'une ouverture à la culture des autres, ce dont les opérateurs doivent tenir compte. Des données sociologiques permettent cependant de mesurer une modification des comportements touristiques depuis une trentaine d'années.
Nous l'avons déjà évoqué dans la première partie de ce rapport. Les
crises économiques successives, en provoquant une compression de la part du
budget des ménages consacrée aux loisirs, tandis que par ailleurs le temps de
non travail augmentait, ont entraîné à la fois un raccourcissement des temps de
séjour et une multiplication des déplacements de proximité, ce qui s'est
accompagné d'une exigence accrue des touristes en matière d'offre, et
particulièrement en matière d'offre culturelle. Aux pratiques culturelles
légitimes et traditionnelles, de distinction sociale, s'ajoutent peu à peu,
voire se substituent des souhaits vis à vis d'une connaissance des cultures
populaires, des disciplines scientifiques et techniques, des jardins et espaces
naturels, dans leurs composantes culturelles et historique.
Il s'agit là d'un changement plus général des modes de consommation, quel que soit leur domaine, dans lequel certains économistes et sociologues pensent percevoir l'émergence d'une nouvelle génération de consommateurs plus conscients et plus "actifs".
De la sociologie aux chartes
Chartes et
recommandations
On pourrait citer par dizaines les réunions qui se sont tenues au sein des grandes organisations internationales, comme des pastorales du tourisme sur la question du tourisme culturel. Elle ont abouti à un ensemble de codes de bonnes pratiques et de chartes, régulièrement actualisées. Mais certaines de ces organisations ont aussi encouragé la mise en œuvre pratique de ces résolutions sous forme de thèmes, de routes ou d'itinéraires transcontinentaux ou européens.
Lors d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles les 8 et 9 novembre 1976, différents partenaires culturels et touristiques réunis par l'ICOMOS ont signé la Charte du tourisme culturel. Sans en citer tous les termes, on peut en reprendre le paragraphe 2 de la première version :
"Considéré dans la perspective du quart de siècle à venir, situé dans le contexte des phénomènes d'expansion lourde de conséquences avec lesquels l'Humanité se trouve confrontée, le Tourisme apparaît comme un des phénomènes susceptibles d'exercer sur l'environnement de l'Homme en général, sur les sites et monuments en particulier une influence extrêmement significative. Pour rester supportable, cette influence doit être soigneusement étudiée, et faire l'objet à tous les niveaux d'une politique concertée et effective. Sans prétendre répondre en tout à ce besoin, la présente approche, limitée au tourisme culturel, se croit constituer un élément positif de la solution globale requise."
La version la plus récente dénonce bien à quel
point en une trentaine d'années la globalisation a fait des ravages et combien,
comme dans la Convention Européenne du paysage, le respect et l'implication des
"communautés d'accueil et des populations locales" sont maintenant
sollicités, dans un partage des responsabilités entre secteur public et secteur
privé. Enfin, en insistant sur la qualité de l'interprétation du patrimoine et
la "large redistribution des bénéfices", cette Charte se place sur
les deux principaux terrains où se situent les conflits d'intérêt : le terrain
des médias et celui de l'économie.
L'offre et la demande - les
politiques communes
Enfin, une étude que l'Agence Européenne de la Culture a menée en coopération avec le Conseil de l'Europe, l'UNESCO et l'Union Européenne s'est traduite par la "Déclaration de Majorque" (novembre 1995) dont l'une des recommandations principale est double : "Elargir et diversifier l'offre - Mobiliser et éduquer la demande".
Elle résume ses recommandations en ces termes :
"Pour que le tourisme culturel puisse remplir la fonction que nous lui assignons, il faut qu'il englobe l'ensemble des secteurs thématiques correspondant à la conception et aux dimensions actuelles de la culture, conception qui ne concerne pas seulement le patrimoine "noble" et les arts et lettres, illustration paradigmatique de la culture "cultivée", mais s'étend à la culture populaire, à la culture de masse et au sens anthropologique de la culture du quotidien. Ainsi le patrimoine ethnographique, les pratiques et les aspects domestiques de l'expérience culturelle, et spécialement, la diversité linguistique. Cette conception large de la culture permet l'élargissement et la diversification de l'offre du tourisme culturel."
Durant la décennie culturelle, en particulier au travers d'un groupe de recherche coordonné par le bureau de Venise de l'UNESCO, cette Organisation s'est penché sur la notion de tourisme durable, rejointe en cela par l'Université de Rotterdam, par l'ICOMOS et par le réseau AVEC. Elle a cherché à créer un système d'aide à la décision "Decision Support System" pour les responsables du tourisme dans les villes d'art.
Enfin, l'Organisation Mondiale du Tourisme s'est régulièrement penchée sur la question de l'éthique du tourisme et a procédé en 1997 à une comparaison très intéressante des politiques touristiques des pays européens.
Elle est rejointe en cela par la Commission Européenne qui, après l'année du tourisme 1992 et l'aide apportée au tourisme rural, a publié en 1995 un livre vert sur la destination Europe. Depuis le refus de certains pays de l'Union Européenne en 1997 d'envisager une politique commune aux pays européens, la Commission a surtout travaillé sur la question de l'effet du tourisme sur l'emploi et sur l'importance de mettre en œuvre les nouvelles technologies dans ce secteur.
Une Résolution du Conseil sur l'avenir du tourisme européen datant du début 2002 invite la Commission, les états membres et les autres acteurs du secteur du tourisme à : "Réfléchir aux moyens de renforcer la position et l'image de l'Europe en faisant fond sur la diversité et l'attrait des destinations qu'elle offre et à la manière d'assurer dans le futur une croissance durable du tourisme européen."
Toutes ces initiatives mériteraient certainement d'être mieux coordonnées, mais elles laissent au moins la possibilité aux responsables du tourisme de prendre leurs responsabilités. Elles laissent cependant ouverte la question d'un observatoire régional des politiques du tourisme culturel.
Michel Thomas-Penette, Directeur
Luxembourg, le 28 février 2003
Liste des
réunions, des missions et des personnes rencontrées
depuis le
début de cette étude.
- 21 novembre 2002. Tourisme et musées. Communauté française de Belgique. Bruxelles. Rencontres avec les responsables des études sur la mise en œuvre de plans de développement touristiques de la Région Wallonne.
Monsieur Guy Lemaire, Journaliste RTBF, Présentateur de l’émission « Télétourisme » et les conseillers de Monsieur Jean-Pierre Lambot, Commissaire général du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne.
-
27-29 novembre 2002.
"La Cultura como elemento de unión en Europa.
Rutas Culturales activas". Rencontres avec des experts et des élus
espagnols de Castille et Léon, de La Rioja, d'Andalousie, de Galice et de
Catalogne. Rencontres avec des experts portugais (Région Centre), italiens
(Toscane et Sicile), anglais (Cornouailles).
Madame Ana
Carreno Leyva (Granada), office du communication d'El-legado andalusi.
Madame Ana
Barbero (Coimbra), responsable de la Rota dos Escritores do Séc. XX.
Monsieur Geoff
Wolstencroft (Helston, Cornouailles), expert de l'Institut en tourisme
culturel.
Madame Mariachiara
Pozzana (Florence), expert de l'Institut sur le paysage.
Monsieur Antonio Barone (Palerme), expert en tourisme et développement local.
- 17 janvier 2003. Forum du tourisme de Luxembourg. "Héritage mondial - potentiels touristiques et stratégies innovatrices des produits". Rencontres avec des responsables de la mise en tourisme des sites du Patrimoine mondial au Luxembourg et en Allemagne.
Monsieur Jean-Pierre
Kraemer, Président de la Commission de l'Unesco à Luxembourg.
Docteur Karin Dengler-Schreiber (Bamberg),
Heimatspflege.
Monsieur Christoffer Richartz (Berlin),
Staatliche Museen zu Berlin.
Monsieur Robert L. Philippart (Luxembourg), Directeur de l'Office National du Tourisme de Luxembourg.
- 17 janvier 2003. Restauration et valorisation touristique des sites du patrimoine mondial. Rencontres avec des responsables de Commissions nationales de l'Unesco.
Monsieur Traugott
Schöfthaler, Secrétaire-Général de la Commission allemande pour l'Unesco.
Monsieur Jean-Pierre
Boyer, Secrétaire-Général de la Commission française pour l'Unesco.
Monsieur Jean-Louis Luxen, Ancien Secrétaire-Général de l'Icomos.
- 31 janvier-1er février 2003. Réunion à Interarts - Barcelone. Constitution du groupe d'experts pour une étude destinée à la D.G. X de l'Union Européenne sur les coopérations culturelles et patrimoniales, bi et multilatérales, entre les 31 pays éligibles aux crédits européens dans le domaine de la culture. L'Institut est chargé de la partie de l'étude concernant le patrimoine culturel.
Monsieur Greg
Richards (Tilburg, Pays-Bas), expert sur le tourisme culturel, responsable
du groupe de recherche en statistiques touristiques de l'Université de Tilburg.
-
20-21 février 2003.
Séminaire organisé par la Cassa di Risparmio di Firenze. Alla scoperta del
territorio. Percorsi alternativi o complementari : il nuovo turismo culturale.
Rencontres avec des experts nationaux et régionaux et des élus régionaux et
locaux.
Monsieur Guido Venturini (Milan), Président du Touring Club Italiano.
Monsieur Timothy
Verdon (Rome), Président de la Fédération internationale des guides
bénévoles dans les églises historiques.
Monsieur Alain
Madeleine-Perdrillat (Paris), Directeur de la Communication des Musées
Nationaux français.
Monsieur Leonardo
Domenici (Florence), Maire de Florence.
Monsieur Emilio
Becheri (Florence), adjoint au tourisme, coordinateur du rapport sur le
tourisme italien.
Monsieur Mario
Augusto Lolli Ghetti, Soprintendente Regionale per i Beni e le Attivita
Cultural per la Regione Toscana.
Madame Elisabetta
del Lungo (Florence), Assessore alla Cultura della Provincia di Firenze.
Monsieur Mario
Carniani (Rome), Président de l'Association des guides touristiques.
Monsieur Paolo
Giacalone, Président de l'Association des hôteliers de Florence et de la
Province de Florence.
Ce rapport a été rédigé par Michel Thomas-Penette, Directeur de l'Institut Européen des Itinéraires culturels sur la base de l'expérience acquise par une collaboration étroite avec le Secrétariat du Conseil de l'Europe de 1987 à 1991 en tant qu'expert consultant pour l'itinéraire des Routes de la Soie et le tourisme culturel, puis de 1992 à 1997 comme conseiller de programme pour le programme des itinéraires culturels et enfin de 1997 à 2003 comme Directeur de l'Institut Européen des Itinéraires culturels à Luxembourg.
(1) Conditions de rédaction du rapport
A la suite de la demande du Secrétariat du Conseil de l'Europe du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux, le Bureau du Conseil d'Administration de l'Institut Européen des Itinéraires culturels a accepté que malgré la faible rémunération proposée (1.000 Euros), l'Institut prépare un rapport visant à aider le Congrès en ce qui concerne les questions du tourisme culturel - sous différents aspects - en relation avec leur mise en œuvre pratique dans les Régions d'Europe et en tenant compte de l'implication des thèmes et de la mise en œuvre des itinéraires culturels élus par le Conseil de l'Europe.
Mais ce rapport devait être rédigé dans un délais beaucoup trop court - un peu plus d'un mois entre la date de la commande et le 12 décembre 2002 - alors qu'il nécessitait de réaliser une actualisation des données réunies par l'Institut depuis cinq années et d'interroger des experts et des acteurs régionaux.
Outre le fait que de tels experts ne sont pas mobilisables du jour au lendemain, leur implication risquait d'amener l'Institut à engager des frais importants et disproportionnés par rapport à la rémunération prévue pour qu'ils actualisent eux aussi les données qu'ils possèdent - le plus souvent au niveau national - en les recentrant sur des faits précis concernant les Régions.
Nous avons donc du considérer qu'il s'agissait d'abord de permettre au Comité de la Culture et de l'Education du Congrès de disposer de grandes lignes d'analyse, de recommandations générales, de repères sur des études de cas et de repères bibliographiques.
Un approfondissement pouvant être réalisé par la suite à sa demande.
Et nous avons donc également renoncé à une rémunération, même faible puisque le rapport aurait du être envoyé pour la mi-janvier pour pouvoir bénéficier des honoraires.
Nous avons par ailleurs retenu une solution intermédiaire en valorisant les acquis de notre expérience passée et en nous appuyant sur les missions de l'Institut au cours de ces derniers mois.
Cette solution, même si elle nécessitait un délais supérieur à un mois et demi, avait toutefois l'avantage de donner une image actuelle de la question sans peser sur le budget de l'Institut - qui reste beaucoup trop faible au regard de ses missions - et sans surcharger les personnels, déjà fortement engagés durant cette période dans le travail de finalisation du nouveau site - portail (10)
Ce rapport s'appuie donc bien entendu sur les nombreux contacts établis depuis une quinzaine d'années avec des partenaires de pratiquement tous les pays signataires de la Convention culturelle Européenne, sur une analyse des cas pratiques de mise en œuvre d'itinéraires culturels, sur une centaine de réunions portant sur le tourisme culturel auxquelles le rédacteur a participé et au cours desquelles il est intervenu, ainsi que sur les rapport de mission réalisés par différents experts pour le compte de l'Institut.
Mais de manière à réaliser cette actualisation dans des conditions qui n'engagent pas trop de frais, il se fonde aussi sur un ensemble de réunions et de missions auxquelles l'Institut a été invité à participer dans la période comprise entre novembre 2002 et février 2003.
Au cours de ces missions le rapporteur a réuni les textes d'un grand nombre de communications et a conduit de courtes interviews avec des responsables présents, dont certains étaient d'ailleurs des experts que l'Institut avait recommandés aux organisateurs.
La préparation de ce rapport nous a de plus convaincu qu'au-delà de sa version synthétique, que nous mettons gracieusement à disposition du Congrès, il méritait de faire l'objet d'un enrichissement continu, en quelque sorte d'un "work in progress" sur la mise en place du tourisme culturel dans les Régions d'Europe.
Tous les exemples cités devront faire - au moins dans un premier temps - l'objet de citations plus complètes et de l'addition de références détaillées, ainsi que de la mise en place d'annexes. Il sera ensuite possible de pratiquer pour chacun d'eux une analyse plus fine.
C'est pourquoi nous avons choisi d'en faire un objet d'étude permanent susceptible de développements dans différentes directions :
- sur le site web de l'Institut (10), en relation avec les domaines et avec différents niveaux d'accès - grand public, abonnés, partenaires, associés… :
- L'Europe découverte
(Rubrique : Tourisme culturel);
- L'Europe de la mémoire
(Rubrique : Itinéraire des lieux de mémoire);
- Médiation européenne
(Rubrique : tourisme et patrimoine);
- Atlas des itinéraires culturels (tous les thèmes qui se prêtent à des circuits régionaux ou inter régionaux à l'échelle européenne).
- sous forme de séminaires de formation pour les élus et les administratifs des Régions concernées et selon leurs domaines de compétences;
- sous forme de documents destinés aux Régions qui souhaitent un diagnostic plus détaillé, en commençant par la Région Toscane pris comme cas d'étude pilote;
- sous forme d'une application par étape avec nos partenaires actuels des itinéraires du Sud-Est européen, les Etats du Caucase demandeurs en matière d'itinéraires culturels et les futurs Centres de Ressources régionaux prévus dans le cadre de l'Accord Partiel élargi sur le "Centre Européen des Itinéraires et du paysage culturel". (11)
Il s’agissait là de quelques pistes qui devaient être complétées lors d’une intervention plus longue, mais qui ont ouvert la discussion.
EUROPE DESTINATION EUROPE: Le tourisme et l’Europe dans les organisations internationales (IV)
(3) L'itinéraire de la Langue castillane n'a pas reçu le label du Conseil de l'Europe, malgré un travail d'extension de l'itinéraire vers les villes d'émigrations séfarades de la Méditerranée. Un prochain post sera consacré à l'analyse de ce projet d'itinéraire euro-méditerranéen, aujourd'hui purement castillan et soutenu par les autorités touristiques espagnoles.
(4) L'itinéraire de Léonard de Vinci n'a été certifié par le Conseil de l'Europe qu'en 2024. Un post spécifique sera également consacré aux archives des étapes qui ont conduit à sa reconnaissance pendant les vingt dernières années.
(5) L'itinéraire "Destination Napoléon" a reçu la mention du Conseil de l'Europe en 2015. J'ai préparé plusieurs textes pour le Comité scientifique de l'Itinéraire, dont je suis membre, textes qui feront l'objet de posts spécifiques.
(6) La Route d'Enée a reçu la mention du Conseil de l'Europe en 2021. Il fera lui aussi l'objet d'un post spécifique sur les réflexions collégiales concernant les personnages européens.
(7) (8) Les textes de ces colloques n'étant plus accessibles, il feront l'objet d'une nouvelle publication sur ce blog.
(9) La Charte de Khiva qui a été signée en 1999 lors d'une réunion de l'UNESCO sur les Routes de la soie a été rédigée en collaboration avec l'IEIC et contresignée de concert.
(10) Sur la question de l'inaccessibilité du site en question on peut lire le premier post de ce blog : Palimpseste
(11) Deux centres de ressources dotés de sites web créés en interaction avec le site principal ont été inaugurés à Sibiu (2005) et Sofia (2006). Ils ont été fermés à peine dix années plus tard, sans aucune concertation préalable, malgré leur faible coût et les inaugurations officielles réalisées en présence des autorités luxembourgeoises, ainsi que celle des pays et villes concernés.







.png)




























.jpg)







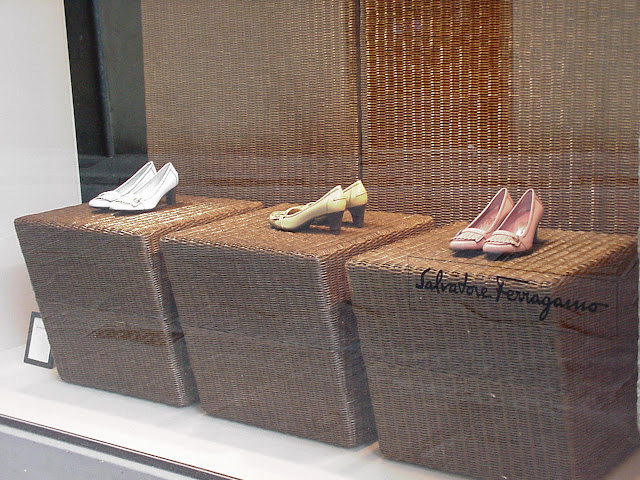










Commentaires
Enregistrer un commentaire